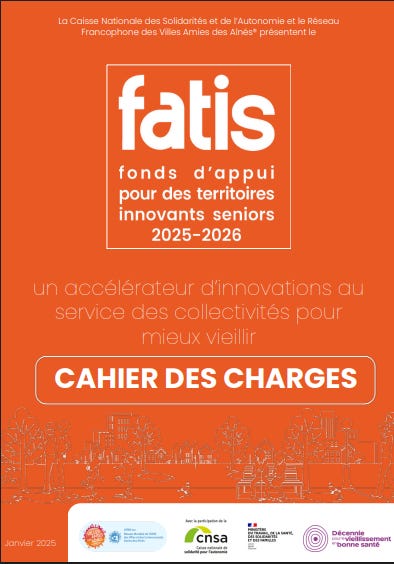Comment les villes gagnent la bataille de l'attractivité senior
Le fonds d'appui pour des territoires innovants seniors transforme la manière dont les territoires s'adaptent au vieillissement
Le passage à la retraite marque une étape décisive dans la vie des citoyens. Avec l'allongement de l'espérance de vie, cette période s'étend désormais sur deux, voire trois décennies. Un temps où les projets de vie évoluent, où les besoins changent et où la relation au territoire se transforme.
Pour les collectivités locales, répondre aux attentes de cette population croissante devient un enjeu d'attractivité.
Comment garantir aux seniors la possibilité de vieillir en conservant leur autonomie, leur place dans la cité et leur sentiment d'utilité sociale ?
Comment créer un environnement qui favorise le lien social, l'inclusion et la participation active à tous les âges ?
C'est à ces questions cruciales que s'attaque le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés (RFVAA).
Loin des approches centrées uniquement sur la dépendance, ce réseau accompagne les territoires dans une démarche ambitieuse : adapter leur environnement urbain et social pour offrir des perspectives désirables à leurs citoyens vieillissants.
Une approche qui repose sur la conviction que les seniors ne sont pas un problème à résoudre, mais une ressource précieuse pour la vitalité locale.
Pour soutenir concrètement cette transformation, le réseau a développé un outil novateur : le Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors.
Ce dispositif permet aux collectivités d'enclencher une démarche d'amélioration continue de leur attractivité auprès des seniors, en identifiant et en renforçant les facteurs qui font d'un territoire un lieu où il fait bon vieillir.
Le Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés : une démarche structurée pour les collectivités
Né en 2012 dans le sillage du programme "Villes et communautés amies des aînés" lancé par l'Organisation Mondiale de la Santé, le RFVAA compte aujourd'hui près de 250 collectivités adhérentes. Ce réseau, officiellement affilié à l'OMS en France et dans l'espace francophone, propose une démarche participative et transversale d'adaptation des territoires.
La démarche "Ville Amie des Aînés" s'articule autour de huit thématiques couvrant l'environnement bâti et social : habitat, espaces extérieurs, transport, participation sociale, respect et inclusion, communication, culture et loisirs, participation citoyenne et emploi, soutien communautaire et services de santé.
En 2021, le réseau a lancé le label "Ami des Aînés", qui reconnaît l'engagement des collectivités dans cette démarche d'adaptation et de valorisation des aînés.
Le Fonds d'appui : soutenir l'innovation territoriale
Le Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors a été créé à l’initiative du ministère de l'Autonomie et de la Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie (CNSA). Il répond au besoin des collectivités en ressources financières et méthodologiques pour développer des politiques adaptées.
Ce dispositif s'organise autour de deux axes. Le premier facilite l'accès à l'ingénierie de projet, permettant aux territoires de structurer leur gouvernance, réaliser un état des lieux, mettre en place une démarche participative et élaborer un plan d'action. Le second soutient la création de projets concrets : améliorations de l'espace public, actions de communication adaptées, ou équipements pour les tiers-lieux.
La spécificité de ce fonds réside dans son approche globale du vieillissement. Il dépasse le simple traitement de la perte d'autonomie – qui concerne moins de 10 % des plus de 60 ans en France – pour améliorer la qualité de vie pendant la vieillesse en transformant l'environnement social et bâti.
Pour comprendre la genèse et les objectifs de ce dispositif, nous avons rencontré Pierre-Olivier Lefebvre, délégué général du Réseau Francophone des Villes Amies des Aînés, qui a coordonné la création de ce fonds.
"Le Fonds d'Appui pour les Territoires Innovants Seniors : un levier pour transformer l'approche du vieillissement"
Interview de Pierre-Olivier Lefebvre, Délégué général du Réseau Francophone Villes Amies des Aînés.
Quelle est l'origine de ce fonds d'appui et de votre collaboration avec la CNSA ?
Le fonds a été créé par trois acteurs clés : le ministère de l’autonomie, la CNSA et notre réseau, suite à l'identification de lacunes dans l'accompagnement des territoires face au vieillissement. Notre réseau a été choisi pour gérer ce fonds grâce à notre expertise et notre approche globale.
Le dispositif s'articule autour de deux axes principaux : l'ingénierie de projets pour améliorer la gouvernance et la démarche participative (Axe 1), et le financement de projets concrets comme le mobilier urbain adapté et l'amélioration de l'accessibilité (Axe 2).
Le cahier des charges met l'accent sur le passage d'une approche curative à préventive du vieillissement. Comment le fonds d'appui concrétise-t-il cette évolution ?
Les collectivités adhérentes à la démarche Villes Amies des Aînés s'engagent à traiter la longévité à travers huit thématiques touchant l'environnement social et urbain.
Notre approche préventive vise à intégrer les besoins des seniors dans chaque politique publique, plutôt que de créer des solutions spécifiques. Nous finançons des aménagements concrets comme le mobilier urbain adapté et l'éclairage public.
L'environnement bâti et social sont interconnectés : au-delà des visites à domicile, la lutte contre l'isolement passe d'abord par la liberté de mouvement. Un territoire bien aménagé permet de passer du "vivre à cause de son âge" au "vivre avec son âge".
Quels sont les principaux résultats observés dans les villes bénéficiaires du fonds ?
Les villes ont compris l'importance du travail d'ingénierie pour dresser un portrait complet de leur territoire et comprendre les attentes réelles des habitants. Cette analyse révèle souvent que la redéfinition des services existants est plus pertinente que la création de nouveaux dispositifs.
Sur le terrain, les pratiques évoluent concrètement. Les services techniques collaborent désormais avec le CCAS pour l'achat et le placement du mobilier urbain, tandis que les collectivités testent leurs aménagements via des parcours à pied et des prêts de mobilier.
Cette approche collaborative évite les erreurs courantes, comme le déplacement constant de bancs faute de concertation initiale avec les habitants.
Le fonds d'appui favorise-t-il une vision à long terme ?
En effet, il s'agit d'un investissement à long terme. Notre apport ne se limite pas à une méthodologie de projet — nous instaurons également des habitudes de dialogue en établissant une relation de confiance entre les différentes parties prenantes. Cette approche évite que certains acteurs craignent la pression ou l'imposition des vues des autres.
Un territoire « ami des aînés » qui fonctionne bien se reconnaît à ceci : lorsqu'un projet aboutit, personne ne se souvient qui en a eu l'idée initiale, tant le travail collectif l'a façonné. C'est un véritable changement de regard, particulièrement pour les acteurs réticents aux démarches participatives.
Notre rôle en tant que réseau est également de créer des outils pour faciliter ces démarches participatives, encourageant les habitants à s'impliquer sans que cela ne se transforme en cahiers de doléances ou en confrontation avec les élus. La construction d'une relation de confiance et l'apprentissage du dialogue malgré les divergences demandent du temps, mais sont essentiels à la réussite des projets.
Comment le fonds contribue-t-il concrètement à transformer la perception du vieillissement dans les territoires ?
La démarche Villes Amies des Aînés repose sur trois piliers. D'abord, la lutte contre l'âgisme en considérant les seniors comme des citoyens à part entière. Ensuite, le renforcement du lien au territoire, en valorisant l'attachement des habitants à leur lieu de vie. Enfin, une approche globale qui implique tous les acteurs au-delà du secteur médico-social.
Cette vision intégrée trouve sa place dans la Silver Économie. Les seniors ne cherchent pas à être pris en charge, mais à s'épanouir de façon autonome, avec un accompagnement uniquement en cas de besoin.
Quels sont les critères d'éligibilité pour bénéficier de ce fonds d'appui ?
Concernant les conditions d'accès au fonds, deux volets distincts existent. L'axe 1 (ingénierie) requiert l'adhésion à la démarche Villes Amies des Aînés et un engagement vers la labellisation. L'axe 2 (financement de projets) nécessite d'avoir un plan d'action déjà validé dans le cadre de la démarche. Tout projet soumis doit correspondre à l'un des trois axes thématiques du cahier des charges.
Comment cette démarche permet-elle de valoriser les seniors en tant que ressource pour le territoire ?
Un aspect fondamental de notre approche est sa dimension positive. Nous ne suivons pas une logique d'obligation ou de dette envers les seniors, mais valorisons plutôt ce qui fonctionne déjà bien. Notre objectif est d'inciter les acteurs extérieurs au domaine social à découvrir comment leur métier et leurs innovations peuvent enrichir la filière Silver Économie.
Les habitants âgés représentent une véritable ressource pour le territoire, au-delà de leur rôle d'usagers ou de clients. Notre démarche favorise des échanges réciproques entre tous les acteurs. Les aînés ont une expertise à partager, c'est pourquoi notre approche participative privilégie le dialogue mutuel plutôt qu'une démarche descendante.
Quels sont les effets mesurables de cette démarche sur l'attractivité des territoires ?
C'est une question complexe, car nous n'avons pas encore d'études systématiques sur ce sujet. La seule étude comparable a été menée par l'OMS avec la ville de Kobe au Japon. Elle comportait une question subjective mais révélatrice : « Depuis que votre territoire est devenu Ami des Aînés, avez-vous le sentiment que votre parole est mieux prise en compte ? » Le test de cette question auprès des habitants a donné des résultats encourageants : environ 75 % ont répondu positivement, y compris des personnes qui ne connaissaient pas précisément le programme.
Face à la question de l'attractivité, les territoires ne sont pas tous égaux. Certains s'inquiètent de l'arrivée de nouveaux seniors sans disposer des services de santé adaptés à cette population croissante. Notre démarche privilégie l'amélioration de la qualité de vie des habitants actuels et futurs plutôt que la simple attractivité.
Les flux migratoires des seniors évoluent de façon notable. Dans les habitats inclusifs, nous observons qu'environ la moitié des résidents sont originaires du bassin de vie, l'autre moitié étant venue se rapprocher de leur famille. Ces dynamiques méritent une analyse plus approfondie.
Pour cette raison, nous conseillons aux collectivités d'inclure les retraités dans leurs journées d'accueil des nouveaux habitants. La vision traditionnelle limitée aux étudiants et aux familles actives ne correspond plus à la réalité démographique actuelle, ce qui nécessite de repenser l'accueil des nouveaux arrivants.
De la méthode au terrain : l'accompagnement personnalisé des collectivités
L'entretien avec Pierre-Olivier Lefebvre met en lumière la philosophie et les objectifs généraux du Fonds d'appui. Pour explorer plus concrètement sa mise en œuvre, nous nous sommes tournés vers Elodie Llobet, experte en accompagnement des collectivités dans le cadre de la démarche Ville Amie des Aînés.
Son travail consiste notamment à guider les territoires à travers les différentes étapes de la démarche : mise en place d'une gouvernance efficace, réalisation d'un diagnostic territorial, animation de la participation des habitants et élaboration de plans d'action adaptés. Elle apporte un éclairage pratique sur les défis que rencontrent les collectivités et les facteurs clés de réussite pour transformer concrètement les territoires.
"La démarche Ville Amie des Aînés : construire un véritable projet de territoire"
Interview d'Elodie Llobet, directrice du cabinet d’études et de recherche Generacio, prestataire référencé dans l’accompagnement de collectivités sur la démarche Ville Amie des Aînés.
Quel accompagnement proposez-vous aux collectivités dans la démarche Ville Amie des Aînés (VADA) ?
Notre accompagnement sur les démarches VADA s'inscrit dans la durée, généralement sur une période de six mois. Il s'articule autour de plusieurs axes structurants : la réalisation d'un diagnostic territorial complet sur l'ensemble des thématiques VADA, la création d'un écosystème partenarial solide et la mise en place d'une gouvernance efficace, tant en interne qu'en externe.
Au cœur de notre approche se trouve l'implication des habitants dans toute leur diversité. Nous les associons étroitement à l'élaboration du plan d'action, puis guidons la collectivité vers la labellisation. Notre volet formation s'adapte aux besoins spécifiques : formations du conseil municipal et des élus, conférences avec les partenaires locaux ou interventions thématiques ciblées.
Aujourd'hui, notre accompagnement inclut également l'évaluation des territoires engagés de longue date ou des premiers labellisés. Notre philosophie est d'intervenir « en dentelle », en proposant un accompagnement sur mesure adapté au contexte de chaque territoire.
Quels défis rencontrent les collectivités au début de la démarche ?
Le premier défi est celui de l'ampleur du projet : les collectivités peinent souvent à structurer leur démarche malgré une vision claire de l'objectif. Notre méthodologie structurée et notre accompagnement personnalisé permettent d'avancer étape par étape.
Le second défi concerne la transversalité. Bien que souhaitée par tous, sa mise en œuvre reste complexe. La démarche Ville Amie des Aînés offre l'opportunité de concrétiser cette ambition via la formation des équipes.
Enfin, l'enjeu est d’impliquer des seniors qui ne sont pas “connus” par les différents acteurs ou des “habitués” des activités proposées par la ville. Pour cela, nous mobilisons les partenaires locaux et nous travaillons pour lever les freins à la participation, par exemple en développant du transport à la demande lors des concertations publiques, ou en allant directement vers les personnes isolées ou dans les EHPAD et résidences autonomie.
Comment intégrez-vous la transversalité dans les collectivités ?
La transversalité, c'est plus qu'une simple théorie : elle doit se traduire concrètement dans le travail quotidien .
Pour que cette approche fonctionne, chaque service de la ville doit y trouver son intérêt. Il ne s'agit pas seulement de ce que chaque service peut apporter au projet "Ville Amie des Aînés", mais aussi de ce qu'il peut en retirer. Nous créons de nouvelles idées tout en améliorant les projets qui existent déjà, en y ajoutant une dimension qui profite à toutes les générations.
La transversalité demande que tous les services travaillent ensemble et comprennent deux choses essentielles : comment le projet "Ville Amie des Aînés" peut améliorer leurs activités actuelles, et comment leurs activités peuvent enrichir ce projet.
En quoi cette démarche transforme-t-elle la politique senior en projet de territoire ?
Cette approche représente un changement important dans la façon de penser et concevoir le territoire. La démarche VADA questionne l’ensemble des thématiques qui font un projet de territoire : habitat, mobilité, grands projets, politiques culturelles, accès aux services et aux soins, accès à l’information. Pour autant, il est intéressant qu’elle se maille également avec les politiques publiques qui s'adressent aux autres générations sur le territoire afin de fonctionner en cohérence et complémentarité.
Cette façon de voir les choses aide à dépasser les idées reçues sur le vieillissement et elle permet de mieux coordonner par exemple VADA avec d’autres programmes, comme les CTG (conventions territoriales globales), la labellisation, "Ville Amie des Enfants" ou encore le programme “Petites Villes de Demain”. L’objectif est de créer une politique globale qui profite à tous les âges.
La démarche VADA permet également souvent de faire évoluer la communication des territoires : au lieu de se concentrer sur ce que les personnes âgées ne peuvent plus faire, nous mettons en avant ce qu'elles peuvent apporter à la société. Cette vision positive renforce leur sentiment d'être des citoyens utiles et actifs, plutôt que d’axer le regard sur l'angle de la dépendance ou de la perte d'autonomie.
Quelles sont les clés pour réussir sa démarche Ville Amie des Aînés ?
Pour réussir la démarche Ville Amie des Aînés, trois points essentiels sont à retenir :
Tout le monde dans la ville doit bien comprendre le projet et y participer. Cela concerne aussi bien les élus que les employés de la mairie, du directeur aux agents de terrain mais également l’ensemble des parties prenantes (partenaires, associations …). Chaque personne peut apporter quelque chose d'utile, car chacun voit les choses différemment selon son rôle dans la ville. Les habitants sont au centre de la démarche : leur consultation est clé dans la réussite de celle-ci.
La communication est très importante. La façon dont vous parlez du projet montre comment vous le comprenez. Par exemple, si vous le voyez simplement comme un plan pour les personnes âgées, sa portée sera plus limitée. Mais si vous le présentez comme un projet pour toute la ville, votre message sera plus riche. La communication permet de rassembler les seniors autour du projet et favoriser leur participation aux temps de co-construction. À Metz, par exemple, ils ont eu une bonne idée : utiliser des photos avec les “vrais” habitants seniors pour communiquer sur leur plan d’action VADA. Une bonne communication aide à rassembler tout le monde autour du projet et valorise la participation des seniors à la démarche.
Réfléchir la manière dont la démarche VADA va vivre dans le temps est indispensable : quelle gouvernance va être mise en place ? Comment programmer des temps réguliers autour de la démarche avec les habitants et les partenaires ?
Qu'avez-vous appris de l'accompagnement d'une trentaine de territoires ?
Aujourd’hui nous avons accompagné plus de 35 territoires aux profils variés – des zones rurales aux métropoles, en passant par les communes littorales et montagnardes – cela nous offre aujourd'hui un précieux recul pour identifier des tendances significatives.
Cette expertise alimente notre activité de recherche en nous permettant de repérer les signaux émergents communs à plusieurs territoires. Notre étude « Vieillir sur les territoires littoraux à l'ère du changement climatique » qui est disponible sur notre site Internet (www.generacio.fr) illustre parfaitement cette approche, car elle a été réalisée suite à des observations similaires sur différents territoires littoraux.
Cette vision d'ensemble, enrichie par des expériences diversifiées, nous permet d'améliorer constamment notre accompagnement et de proposer aux collectivités des solutions toujours plus adaptées à leurs besoins.
Quel est l'impact du calendrier politique sur la démarche Ville Amie des Aînés ?
Il n'y a pas de moment idéal dans un mandat pour lancer cette démarche. Des territoires peuvent très bien s'y engager en cours de mandat, même sans l'avoir inscrite dans leur projet initial, et réussir pleinement.
Néanmoins, intégrer cette dimension dès la conception d'un projet de mandat est interessant. Lorsqu'une équipe politique prend en compte les enjeux démographiques dans sa réflexion intiale et de manière globale – même pour une commune au profil jeune – cela enrichit considérablement le projet de territoire.
Cette anticipation facilite également la mise en œuvre de la transversalité par la suite. C'est pourquoi j'encourage toutes les équipes à réfléchir dès maintenant à l'intégration de cette dimension dans leurs projets pour les élections de mars 2026, en tenant compte des enjeux spécifiques à leur territoire.
Quelle évolution voyez-vous dans les relations intergénérationnelles au sein des territoires ?
Beaucoup de gens rejettent l'idée d'aller en maison de retraite (EHPAD) ou dans d'autres types de logements spécialisés. On entend souvent : "Je veux rester chez moi pour mes vieux jours". Mais les gens ne réalisent pas toujours que leur maison n'est pas adaptée à leurs besoins futurs. Ce n'est pas juste une question d'avoir une douche à la place d'une baignoire ou d'éviter les escaliers. Un logement peut aussi être mal adapté s'il est loin des magasins, s'il n'y a pas de bus ou de transport, ou si on risque de se sentir seul.
Il y a en fait plusieurs solutions entre rester chez soi et aller en EHPAD, mais elles sont peu connues. Dans nos réunions d'information, les gens découvrent qu'il existe d'autres options comme l'accueil familial, les maisons d'accueil rurales (MARPA) ou les résidences où vivent ensemble différentes générations. Quand on explique aux gens qu'ils peuvent avoir leur propre espace tout en vivant avec d'autres, participer à des activités et garder des contacts sociaux, ils commencent à voir ces solutions d'un meilleur œil.
Conclusion : vers des territoires où il fait bon vieillir
Le Fonds d'appui pour des territoires innovants seniors marque un tournant dans notre approche collective du vieillissement. En encourageant les collectivités à sortir du cadre strictement médico-social, il contribue à construire des territoires où chacun peut trouver sa place, quel que soit son âge.
Ce dispositif produit déjà des résultats tangibles. Des services techniques qui collaborent au-delà de leurs périmètres habituels, des élus qui intègrent la dimension démographique dans leurs projets, des habitants âgés qui retrouvent une voix dans leur territoire... Ces changements dessinent progressivement une transformation de notre société face à l'allongement de la vie.
En combinant expertise, méthodologie et soutien financier, le Fonds d'appui accompagne les collectivités vers des politiques publiques plus inclusives. À l'heure où le vieillissement démographique s'impose comme un enjeu majeur, cette approche préventive, participative et transversale constitue une voie prometteuse pour construire une société où l'âge n'est plus un facteur d'exclusion, mais une dimension respectée de la diversité humaine.